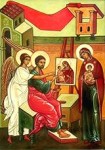J’ai l’impression que l’histoire de la messe de Paul VI est déjà oubliée, ou qu’elle n’est pas connue des jeunes générations. J’attendais qu’un lecteur commente mon texte d’hier à propos du site de la « liturgie catholique », en évoquant l’article 7 de l’Institutio generalis du Novus Ordo Missae. Puisque cela ne vient pas, je le fais moi-même.
La messe de Paul VI fut publiée en 1969, précédée d’une introduction, l’Institutio generalis. L’article 7 disait ce qu’est la messe. Il disait que la messe, la « Cène », est une assemblée du peuple de Dieu, présidée par un prêtre, qui célèbre le mémorial du Seigneur.
Comme il n’y avait ensuite rien qui vienne préciser que ce « mémorial » était un sacrifice, le sacrifice du Fils de Dieu qui se donne à manger aux hommes pour qu’ils aient la vie éternelle, il en résultait qu’il s’agissait à la messe, à la « Cène », de seulement faire mémoire de ce qui s’était passé il y a 2000 ans. Il était seulement ajouté qu’ainsi « l'Eglise locale réalise de façon éminente la promesse du Christ : "Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux." Telle était la seule présence du Christ à la messe (à la Cène).
Face à cette définition si clairement protestante, les critiques furent si vives que dans l’édition suivante cet article fut modifié, et toute la doctrine catholique y fut ajoutée : le prêtre agissant in persona Christi, la messe sacrifice eucharistique qui perpétue le sacrifice de la Croix, le Christ qui se rend réellement présent, substantiellement et durablement, sous les espèces eucharistiques.
La première version de l’article 7 montre bien quelles étaient les intentions de ceux qui ont fabriqué la messe de Paul VI…
On croyait que cela n’était plus qu’un mauvais souvenir. Mais voici que le site officiel de la « liturgie catholique », garanti par les évêques, sous la responsabilité de Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse et président de la Commission épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale sacramentelle, revient, comme si de rien n’était, à la messe où l’on « fait mémoire », non seulement en omettant la doctrine catholique de la messe, mais en précisant lourdement que cette mémoire est « comme » celle que l’on met en œuvre avec le gâteau d’anniversaire…