La fête du 15 août est l’une des plus anciennes fêtes de la chrétienté. On célébrait déjà la Mère de Dieu en ce jour à Jérusalem à la fin du IVe siècle, et sans doute avant. Vers 600, l'empereur Maurice l’étendit à tout l'empire comme fête de la Dormition de Marie. Vers 700, le pape Serge Ier composa cette belle prière pour la fête :
« Vénérable est pour nous, Seigneur, la fête qui commémore ce jour en lequel la sainte Mère de Dieu subit la mort temporelle, mais néanmoins ne put être retenue par les liens de la mort, elle qui avait engendré de sa substance votre Fils, notre Seigneur incarné. » (Traduction de Dom Capelle).
Il existe de nombreux récits de la Dormition. Le plus célèbre est celui qui est attribué à saint Jean l’Evangéliste, et que Jacques de Voragine reprend, à ce qu’il dit, dans sa Légende dorée. En fait, le récit de Jacques de Voragine vient du texte de Méliton de Sarde (qui lui est proche).
« Ce qui vient d’être raconté est apocryphe en tout point », ajoute Jacques de Voragine. Curieuse assertion, de la part d’un auteur qui s’embarrasse si rarement de la véracité ou de la vraisemblance de ce qu’il rapporte. En l’occurrence, il est fort peu probable que le récit soit apocryphe « en tout point ».
D’abord il ne l’est pas en ce sens que les dialogues viennent des psaumes, du Cantique des cantiques et de l’Evangile, et que nombre de situations sont calquées sur l’Evangile. Et ce d’une façon admirable. Cela est visible au premier coup d’œil, et les auteurs ne prennent pas le soin de déguiser leur propos : leur œuvre est quasi-liturgique.
Mais le fond du récit, une fois qu’on a retiré tout l’habillage, recèle (comme dans toute liturgie) une vérité historique : celle de la Dormition de Marie.
On ne peut que constater que les nombreux récits de la Dormition, qui existent dans toutes les langues anciennes de la chrétienté, depuis l’éthiopien jusqu’à l’irlandais, en passant par toutes les langues du Caucase et de la Méditerranée (et l’on en a de nombreux manuscrits, ce qui atteste de l’importance de cette tradition), s’accordent sur les points essentiels alors qu’ils ne sont pas tous de même origine : les spécialistes distinguent trois groupes de manuscrits. (Voir ici, c’est passionnant, car cela nous fait entrer dans le monde des aventuriers de la foi avant les grandes définitions dogmatiques.)
Jacques de Voragine ajoute à l’appui de ce qu’il dit un texte de saint Jérôme. Et saint Jérôme dit en effet qu’on doit regarder le récit comme « entièrement apocryphe », mais il ajoute : « à l’exception de quelques détails dignes de croyance » et « approuvés par de saints personnages ». Ces « détails », qui sont au nombre de neuf, précise-t-il, constituent en réalité tout l’essentiel : « à savoir que toute espèce de consolation a été promise et accordée à la Vierge, que les apôtres furent tous réunis, qu’elle trépassa sans douleur, qu’on disposa sa sépulture dans la vallée de Josaphat, que ses funérailles se firent avec dévotion, que Jésus-Christ et toute la cour céleste vint au devant d’elle, que les juifs l’insultèrent, qu’il éclata des miracles en toute circonstance convenable, enfin qu’elle fut enlevée en corps et en âme ».
En dehors de l’authenticité difficilement contestable du noyau des récits de la Dormition, et en dehors des forts motifs théologiques qui attestent de sa nécessité, il y a une preuve concrète que l’Eglise (en Orient comme en Occident) a toujours cru en la Dormition, ou Assomption, de la Mère de Dieu : il n’y a jamais eu, nulle part, de vénération de reliques de la Vierge, il n’y a jamais eu de vol ni de marchandage de telles reliques (comme on le voit tout au long de l’histoire avec les reliques des saints), alors qu’elles auraient évidemment été les plus précieuses.


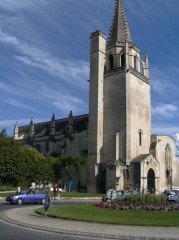
 Chez nous, l’association
Chez nous, l’association