Lu sur Gènéthique :
Après la proposition du groupe Renaissance et celle de la Nupes, c’est maintenant du Sénat qu’émanent des tentatives pour inscrire l’avortement dans la Constitution française. Deux propositions de loi constitutionnelle ont été déposées le 27 juin. L’une est portée par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. L’autre est signée par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Ce sont Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, et Marie-Pierre de la Gontrie, qui sont à l’initiative de ce second texte.
Pour Bruno Daugeron, professeur de droit public à l’Université Paris Descartes, « c’est une tendance lourde de nos gouvernants que de vouloir modifier la Constitution, et plus exactement y ajouter pour répondre, sur le vif, à une question d’actualité politique ». « Y compris quand le sujet ne nous concerne pas », pointe-t-il. « Le rythme du législateur n’est pas et ne doit pas être celui de la communication politique, où l’instantanéité fait des ravages », rappelle Bruno Daugeron.
La protection du climat avait été abordée ainsi. Mais, en l’espèce, « on voyait au moins où la protection du climat pouvait trouver place au sein même du texte de la Constitution » souligne le professeur.
Pour l’avortement, au contraire, « on ne voit nul titre de la Constitution susceptible d’accueillir un tel principe, ni même aucun article si l’on veut conserver à la Constitution son caractère de norme suprême, c’est-à-dire de texte répartissant les compétences entre les différents organes de l’Etat sans se mêler de tout ni se réduire à un inventaire de droits », explique Bruno Daugeron.
Mais le problème est encore d’une autre nature. « Nous sommes ici face à un véritable problème de philosophie du droit », estime de son côté Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l’université Rennes 1 et vice-présidente de l’Association française de droit constitutionnel. « Comment peut-on consacrer dans une Constitution un droit qui n’existe pas au préalable ? », interroge-t-elle.
Car non, l’avortement n’est pas un droit. Ni en France, ni ailleurs, affirme le professeur. D’ailleurs la Cour européenne des droits de l’homme refuse de le reconnaître, rappelle-t-elle.
En effet, « reconnaître un droit à l’avortement supposerait de le relier au droit naturel, qui est l’un des fondements des droits de l’homme », pointe Anne-Marie Le Pourhiet. « Cela signifierait qu’avorter relèverait de la dignité humaine. Or, l’un des premiers principes des droits de l’homme demeure le respect de la vie humaine. »
« Même aux États-Unis, il était très difficile de parler d’un “droit constitutionnel” à l’avortement », estime le professeur. « Cette vision n’a jamais fait consensus dans le monde juridique américain », assure-t-elle.
Pour Anne-Marie Le Pourhiet, ces propositions sont une « réaction épidermique à la décision des juges américains ». Une réaction surprenante, estime-t-elle, quand personne en France ne s’est insurgé devant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande qui affirme, « dans le détail », « que la vie et la dignité du fœtus bénéficient de la même protection constitutionnelle que la liberté de la mère, et qui est allée jusqu’à exiger du législateur qu’il prévoie un entretien tendant à dissuader la femme d’avorter ».
Intégrer l’avortement à la Constitution française « ne changerait strictement rien à la jurisprudence du Conseil constitutionnel », soutient le professeur de droit public. Cette proposition est « dépourvue de sens ».



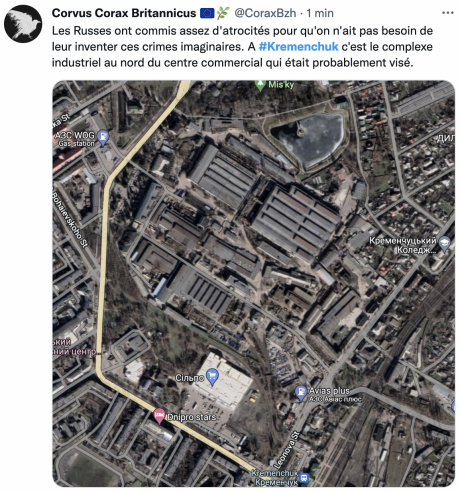





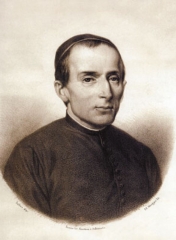 Son secret était simple : être un homme de Dieu ; faire, dans les petites actions quotidiennes, « ce qui peut conduire à la plus grande gloire de Dieu et au bénéfice des âmes ». Il aimait de manière totale le Seigneur, il était animé par une foi bien enracinée, soutenu par une prière profonde et prolongée, il vivait une sincère charité à l’égard de tous. Il connaissait la théologie morale, mais il connaissait tout autant les situations et le cœur des gens, dont il prenait en charge le bien, comme le bon pasteur. Ceux qui avaient la grâce d’être proches de lui en étaient transformés en autant de bons pasteurs et en confesseurs de grande valeur. Il indiquait avec clarté à tous les prêtres la sainteté à atteindre précisément dans le ministère pastoral. Le bienheureux père Clemente Marchisio, fondateur des Filles de Saint-Joseph, affirmait : « J’entrai à l’internat en étant un grand gamin et une tête en l’air, sans savoir ce que voulait dire être prêtre, et j’en ressortit tout à fait différent, pleinement conscient de la dignité du prêtre ». Combien de prêtres forma-t-il au Pensionnat et suivit-il ensuite spirituellement ! Parmi ces derniers ressort saint Jean Bosco, dont il fut le directeur spirituel pendant 25 ans, de 1835 à 1860 : d’abord comme enfant de chœur, puis comme prêtre et enfin comme fondateur. Tous les choix fondamentaux de la vie de saint Jean Bosco eurent comme conseiller et guide saint Joseph Cafasso, mais de manière bien précise : Joseph Cafasso ne tenta jamais de former en don Bosco un disciple « à son image et ressemblance » et don Bosco ne copia pas Joseph Cafasso : il l’imita assurément dans les vertus humaines et sacerdotales ─ le définissant un « modèle de vie sacerdotale » ─ , mais en suivant ses propres inclinations personnelles et sa vocation particulière ; un signe de la sagesse du maître spirituel et de l’intelligence du disciple : le premier ne s’imposa pas au second, mais le respecta dans sa personnalité et il l’aida à lire quelle était la volonté de Dieu pour lui. Chers amis, c’est là un enseignement précieux pour tous ceux qui sont engagés dans la formation et l’éducation des jeunes générations et c’est aussi un fort rappel de l’importance d’avoir un guide spirituel dans sa propre vie, qui aide à comprendre ce que Dieu attend de nous. Avec simplicité et profondeur, notre saint affirmait : « Toute la sainteté, la perfection et le profit d’une personne consiste à faire parfaitement la volonté de Dieu (...). Nous serions heureux si nous parvenions à verser ainsi notre cœur dans celui de Dieu, unir à ce point nos désirs, notre volonté à la sienne au point de former un seul cœur et une seule volonté : vouloir ce que Dieu veut, le vouloir de la manière, dans les délais, dans les circonstances qu’Il veut et vouloir tout cela pour aucune autre raison que parce que Dieu le veut ».
Son secret était simple : être un homme de Dieu ; faire, dans les petites actions quotidiennes, « ce qui peut conduire à la plus grande gloire de Dieu et au bénéfice des âmes ». Il aimait de manière totale le Seigneur, il était animé par une foi bien enracinée, soutenu par une prière profonde et prolongée, il vivait une sincère charité à l’égard de tous. Il connaissait la théologie morale, mais il connaissait tout autant les situations et le cœur des gens, dont il prenait en charge le bien, comme le bon pasteur. Ceux qui avaient la grâce d’être proches de lui en étaient transformés en autant de bons pasteurs et en confesseurs de grande valeur. Il indiquait avec clarté à tous les prêtres la sainteté à atteindre précisément dans le ministère pastoral. Le bienheureux père Clemente Marchisio, fondateur des Filles de Saint-Joseph, affirmait : « J’entrai à l’internat en étant un grand gamin et une tête en l’air, sans savoir ce que voulait dire être prêtre, et j’en ressortit tout à fait différent, pleinement conscient de la dignité du prêtre ». Combien de prêtres forma-t-il au Pensionnat et suivit-il ensuite spirituellement ! Parmi ces derniers ressort saint Jean Bosco, dont il fut le directeur spirituel pendant 25 ans, de 1835 à 1860 : d’abord comme enfant de chœur, puis comme prêtre et enfin comme fondateur. Tous les choix fondamentaux de la vie de saint Jean Bosco eurent comme conseiller et guide saint Joseph Cafasso, mais de manière bien précise : Joseph Cafasso ne tenta jamais de former en don Bosco un disciple « à son image et ressemblance » et don Bosco ne copia pas Joseph Cafasso : il l’imita assurément dans les vertus humaines et sacerdotales ─ le définissant un « modèle de vie sacerdotale » ─ , mais en suivant ses propres inclinations personnelles et sa vocation particulière ; un signe de la sagesse du maître spirituel et de l’intelligence du disciple : le premier ne s’imposa pas au second, mais le respecta dans sa personnalité et il l’aida à lire quelle était la volonté de Dieu pour lui. Chers amis, c’est là un enseignement précieux pour tous ceux qui sont engagés dans la formation et l’éducation des jeunes générations et c’est aussi un fort rappel de l’importance d’avoir un guide spirituel dans sa propre vie, qui aide à comprendre ce que Dieu attend de nous. Avec simplicité et profondeur, notre saint affirmait : « Toute la sainteté, la perfection et le profit d’une personne consiste à faire parfaitement la volonté de Dieu (...). Nous serions heureux si nous parvenions à verser ainsi notre cœur dans celui de Dieu, unir à ce point nos désirs, notre volonté à la sienne au point de former un seul cœur et une seule volonté : vouloir ce que Dieu veut, le vouloir de la manière, dans les délais, dans les circonstances qu’Il veut et vouloir tout cela pour aucune autre raison que parce que Dieu le veut ».