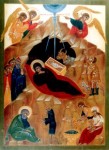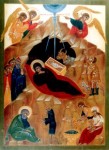 Que voit-on au centre de l’icône byzantine de la Nativité ? On voit, dans un trou noir, un enfant étroitement emmailloté de bandelettes funéraires, déposé dans une tombe de pierre. Près de lui une femme allongée, l’air grave, triste, dont le regard est « tendre compassion » et « surprise douloureuse », pour reprendre les célèbres expressions de Bernanos. Elle ne regarde pas l’enfant. Elle regarde de l’autre côté, les autres personnages, le plus souvent Joseph, plus triste encore, abattu, profondément troublé.
Que voit-on au centre de l’icône byzantine de la Nativité ? On voit, dans un trou noir, un enfant étroitement emmailloté de bandelettes funéraires, déposé dans une tombe de pierre. Près de lui une femme allongée, l’air grave, triste, dont le regard est « tendre compassion » et « surprise douloureuse », pour reprendre les célèbres expressions de Bernanos. Elle ne regarde pas l’enfant. Elle regarde de l’autre côté, les autres personnages, le plus souvent Joseph, plus triste encore, abattu, profondément troublé.
Cet aspect central de l’icône exprime le drame de la Nativité : la kénose du Verbe. Le Dieu éternel, éternellement glorieux, se fait homme, misérable comme tout homme, et comme le plus pauvre des plus pauvres. Il se fait homme pour mourir de façon ignominieuse, au fond de la nuit du monde. C’est ce que sait sa mère, qui l’a déjà enveloppé de bandelettes et mis au tombeau dans le trou noir. Et elle regarde Joseph, tenté par le diable qui lui dit qu’une naissance virginale est impossible. Joseph représentant l’humanité tentée par l’incrédulité, alors que le Sauveur est né pour nous sauver, pour se donner aux hommes en nourriture vivifiante. Une antienne de la liturgie byzantine dit que cette crèche, cette mangeoire, est ce que le désert a donné au Christ qui vient. Comme le désert a donné la manne aux Hébreux, il donne aujourd’hui aux hommes le corps du Fils de l’Homme pour qu’ils aient la vie divine. Mais ce corps devra passer par la mort pour donner la vie.
C’est ce qu’avait remarquablement compris la grande Marie Noël (elle n’avait pas choisi ce pseudonyme par hasard), qui conclut ainsi un de ses chants de Noël :
De chair, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour rompre avec eux le pain du repas…
Ta chair au printemps de moi façonnée,
O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.
De mort, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour sauver le monde… O douleur ! là-bas,
Ta mort d’homme, un soir, noire, abandonnée,
Mon petit, c’est moi qui te l’ai donnée.
C’est ce drame même qui provoque la joie de Noël, visible dans le reste de l’icône. Car la naissance de Dieu sur terre est le signe efficace d’une recréation du monde. La joie du salut, la joie du Royaume manifesté. Mais elle passe par la Croix, qu’annonce la Nativité, comme le salut de chacun de nous passe par la mort de chacun de nous, inscrite en nous dès le jour de notre naissance.
A Noël, le Christ montre le chemin qui transforme le tragique de l’existence humaine en joie divine.